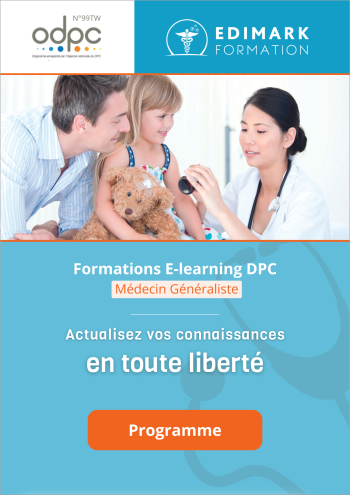Comment garantir la prise en charge de votre formation ?
Pour chaque formation que vous souhaitez suivre, il est obligatoire de disposer d’un compte DPC et de s’inscrire à la session choisie sur le site www.agencedpc.fr. En quelques clics c’est joué !
Connectez-vous sur www.agencedpc.fr
Saisissez votre identifiant et mot de passe dans le bloc à droite de l’écran
Cliquez sur « Recherche actions » dans la colonne à gauche
Renseignez le N° de référence de l’action de formation choisie et cliquez sur « rechercher » ou pour découvrir l’ensemble des formations proposées renseignez simplement le numéro Organisme « 99TW ».
Lorsque l’action s’affiche, cliquez sur « Détail action DPC » à droite
En bas de la fiche, sélectionnez la session de votre choix – Cliquez sur « s’inscrire »
Vous recevez par mail le récapitulatif de la prise en charge de votre formation
Et si je n’ai plus suffisamment de crédit pour financer 100% de la formation que je souhaite suivre ? Edimark Formation vous adresse un devis pour le reste à charge : calcul de la différence entre le coût de votre formation et le montant du crédit encore disponible. Contactez un conseiller au 01 45 74 74 67 ou par mail contact@edimarkformation.fr
Pas encore inscrit au DPC, n’attendez pas pour créer votre compte !
Pour bénéficier de votre crédit DPC, il est obligatoire depuis le 1 er janvier 2013, d’avoir un compte actif sur www.mondpc.fr. 3 étapes rapides suffisent :
Créez votre compte personnel sur www.mondpc.fr
Munissez-vous de votre n° RPPS ainsi que de votre RIB
Vous recevrez alors par e-mail vos identifiants de connexion
Pour être éligible au financement de vos formations par le DPC, vous devez obligatoirement être un praticien libéral ou salarié exerçant dans un centre de santé conventionné.
Comment votre crédit formation est-il utilisé ?
Lorsque vous avez finalisé votre parcours de formation et que la date de fin de session est terminée, nous adressons au DPC les documents nécessaires à votre prise en charge. Le délai de traitement est de 6 semaines.
Le DPC verse à l’organisme Edimark Formation une quote-part pour la conception de la formation.
Le DPC vous verse votre indemnité de formation sur le RIB renseigné lors de votre inscription sur www.mondpc.fr
Edimark Formation vous prélève le complément du montant pour la conception de la formation (dans la limite du plafond de versement que vous avez reçue)